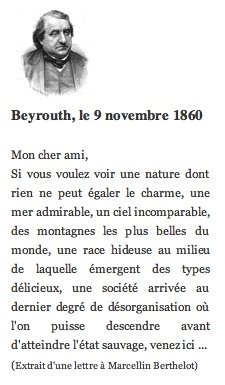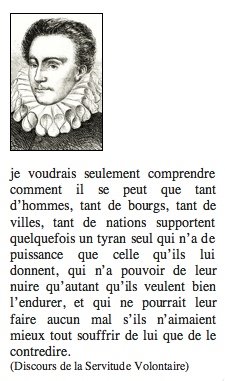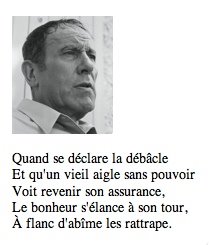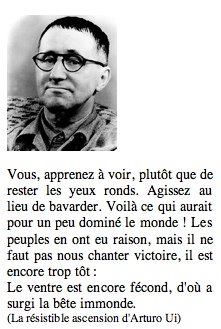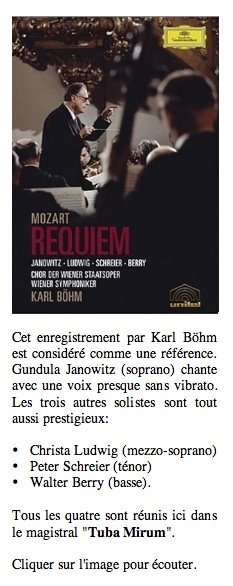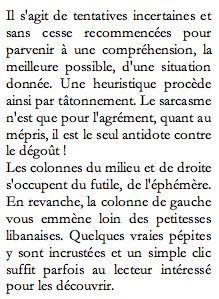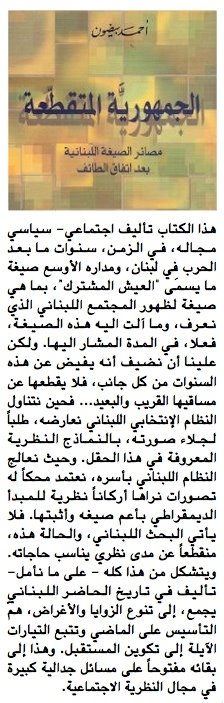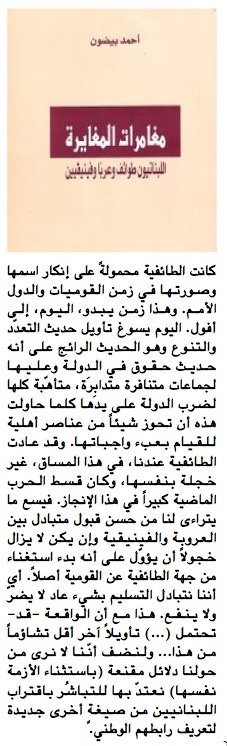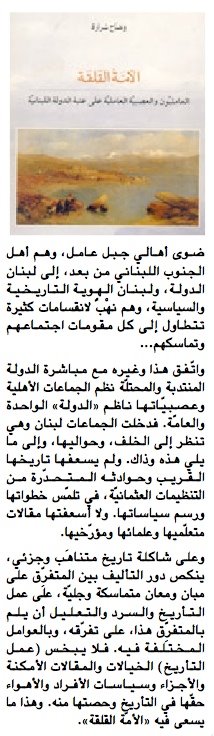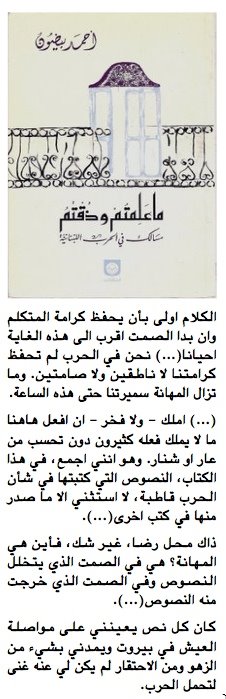La “Formule”, le Pacte et la Constitution
Le Liban confessionnaliste entre démocratie et paix∗
Par Ahmad Beydoun
D’emblée, j’exclue l’éventualité de m’engager dans un débat purement théorique avec l’analyse si conséquente que met sous nos yeux Alain Caillé. La cohérence même de cette analyse me porte déjà à éviter la confrontation; peut-être, d’ailleurs, ne suis-je pas qualifié pour m’engager dans pareille voie.
Aussi ai-je préféré examiner la possibilité pour l’expérience libanaise de contribuer à l’élaboration d’une réponse à l’interrogation formulée par Caillé: la démocratie fait-elle preuve d’une aptitude particulière à prévenir les conflits?
Dans le cas d’espèce, les conflits visés sont, bien évidemment, des conflits à dominante interne. À travers le cas libanais, nous examinons donc la contribution que l’alternative démocratique peut (ou ne peut pas) apporter à la sauvegarde de la paix civile. Les lecons du cas libanais débordent largement, en fait, les limites de ce pays. Le Liban a connu des conflits pluridimensionnels dont le dernier a été le plus durable et le plus destructeur. Ce conflit s’est inséré dans une confrontation régionale dont certaines parties étaient déjà actives sur le sol même du Liban, alors que d’autres sont intervenues de l’extérieur. La confrontation régionale s’est également dotée, dans son expression libanaise, d’une dimension internationale certaine; à tel point que des forces internationales se sont directement engagées dans le pays, sous prétexte de mettre fin aux affrontements, et qu’elles y ont été prises pour cible par des forces adverses présentes sur le terrain. Une guerre de résistance à l’occupation se poursuivait encore, longtemps après le reflux des affrontements civils. De cette dernière guerre, certains effets à caractère régional ou international, continuent, avec leur train de potentialités néfastes, à peser lourdement sur le pays. Plus généralement, le conflit libanais, tant qu’il durait, comptait parmi les arènes de la lutte entre les Grandes Puissances de l’époque.
Dans le cas qui nous occupe, la question des rapports entre paix civile et démocratie recèle, en principe, une autre question: celle relative aux effets qu’exerce un type particulier de “démocratie” (celui que ce pays a fait sien) sur les chances dont la réalisation d’une paix régionale (affublée, bien entendu, de prolongements internationaux) peut être créditées.
Le choix de dérouler notre analyse dans l’espace libanais répond également à un autre besoin: celui de mettre en évidence la base sociale que présuppose l’édification d’une démocratie. C’est là une question qui – nonobstant la possibilité de vérifier la thèse du conditionnement de la démocratisation par le développement économique – déborde largement celle de la détermination du degré de développement économique que la mise en place d’une démocratie requerrait. Notre problématique a plutôt trait à la nature des formations sociales prépondérantes dans l’espace public. Or des facteurs analogues favorisant cette prépondérance peuvent se retrouver dans des sociétés riches et dans d’autres bien démunis. Nous mettons donc en question la possibilité d’imposer la démocratie par la seule force des lois adéquates. Et déjà la possibilité d’importer d’outre mer la démocratie – en vue, par exemple, d’obéir, sur le champ, à un diktat étranger – nous semble bien douteuse.
Trois piliers
Au Liban, les évaluations, positives ou négatives, des comportements politiques s’énoncent, en général, à partir de trois corpus normatifs: la Constitution, le Pacte National et ce qu’on appelle la “Formule” libanaise. Notre traitement de la question que nous venons de poser visera à cerner le réseau de relations que l’histoire contemporaine du Liban a tissé entre ces trois hypostases. Et si nous ne retenons pas l’Accord de Taef comme quatrième pilier de cet édifice, ce n’est guère méconnaissance de la valeur d’un texte qui a ménagé aux Libanais une sortie de la guerre; notre attitude se prévaut, bien plutôt, d’un diagnostic précis des rapports que cet Accord a pu entretenir, dans son élaboration et, plus tard, dans son application, avec les éléments de la susdite triade. En effet, nous pensons que, de par sa prévision d’une phase transitoire dont il a esquissé les traits, cet Accord a représenté un amendement, d’ailleurs rendu inévitable par les changements objectifs qu’a enregistrés l’histoire du Liban indépendant, de la formule libanaise. Il a représenté également un rééquilibrage de deux déclarations de principe que le Pacte avait mises l’une en regard de l’autre et que nous aborderons sous peu. Enfin, l’Accord de Taef a prévu, pour le système libanais, un nouvel état de fait que ce dernier devait atteindre à travers la phase transitoire: état de fait qui devait culminer, du côté de la “Formule”, en la déconfessionnalisation du régime politique et, du côté du Pacte, en l’évacuation du territoire libanais par les Forces armées syriennes. Ces deux conditions n’ayant pas été remplies, l’amendement de la “Formule” tend à se muer en scandale, et celui du Pacte, en assimilation de ce dernier à une simple imposture. Par ailleurs, le procès de réforme constitutionnelle consigné dans l’Accord n’a pu se traduire par l’amélioration de la Constitution qu’il laissait espérer. Ayant fait un premier pas avant de se figer, cette réforme s’est vite vouée à la corruption. L’interprétation unilatérale des clauses de la réforme, son isolement de l’ambiance consensuelle où l’Accord la voulait incluse, ne pouvaient qu’ en accélérer la dégénérescence. Ce qui devait initier une marche en avant, s’est trouvé réduit, en définitive, à un faux pas. Nous en sommes toujours là.
Si donc nous faisions du Pacte national le point de départ de notre analyse, force nous serait de reconnaître que le contenu explicite de ce Pacte reste muet sur la forme – démocratique ou autre – du régime politique. Le Pacte national – rappelons-le – est la dénomination courante de l’entente scellée, à la veille de l’Indépendance du Liban, entre le premier Président de la République émancipée et son premier Président du Conseil. Explicitement, il stipule l’engagement d’une partie des Libanais à abandonner la revendication de l’Unité arabe (ou syrienne) en échange de l’engagement de l’autre partie à s’abstenir de solliciter une protection étrangère. Cependant, le Pacte, en tant que contrat, sous-entend l’érection des parties contractantes en membres fondateurs de l’État indépendant. D’entrée de jeu, il est entendu que ces parties ne sont autres que les communautés confessionnelles du pays. Cette institution des communautés en parties exclusives de la fondation de l’État indépendant se fait sous la couverture d’une autorité autre que que celle du pacte (et que celle de la Constitution que nous aborderons incessamment); cette autorité est celle de la fameuse “Formule” libanaise qui, considérée dans la dimension temporelle, est antérieure à la Constitution et au Pacte.
La Constitution, elle, se situe, quant à ses prémisses, bien à l’écart du modèle confessionnaliste. Elle instaure une République parlementaire “normale” dotée d’une Chambre élue pour une durée déterminée, d’un Gouvernement se prévalant, dans l’exercice de son pouvoir, de la confiance de la Chambre, d’un Président de la République élu par la Chambre et dont le mandat ne peut être reconduit. À la suite, surtout, des amendements de 1990, les prérogatives de ce Président se trouvent être strictement délimitées autant par les dispositions précises qui les définissent que par l’autorité d’institutions dont la principale est le Conseil des Ministres; le Président de ce Conseil est désigné en conformité aux résultats de consultations parlementaires impératives auxquelles procède le Président de la République. Ce dernier n’a pas de pouvoir direct sur l’Administration publique ni sur les Forces armées, ni, bien entendu, sur le corps judiciaire. Sur un autre plan, la Constitution garantit l’égalité de tous devant la Loi, les libertés publiques fondamentales, les droits des personnes et les libertés individuelles. Le système – tout cela porte à l’admettre – remplit les conditions principales de la démocratie: les libertés publiques et privées garanties, l’alternance au pouvoir, la fonction législative assurée par l’Assemblée élue et la nécessité pour l’Exécutif de rendre compte à celle-ci, le contrôle gouvernemental sur l’Administration par l’entremise de corps spécialisés et dans les limites de la Loi, la soumission des corps militaires et de sécurité à l’Autorité politique… sans oublier l’encouragement donné à l’initiative individuelle et à l’entreprise privée, dans la sphère économique, etc. Des carences des garanties juridiques de l’indépendance de la justice, de même que de la transparence du fonctionnement de l’État et de ses appareils, sont souvent soulignées; elles ne remettent pas en question la dominance certaine de l’orientation démocratique dans la Constitution libanaise.
Il en va de même de l’existence, dans le texte de la Constitution, d’accès limitées concédées à l’esprit confessionnaliste. L’énoncé originel de l’article 95 stipulait le partage entre les communautés, “provisoirement et dans un esprit d’équité et de justice”, des portefeuilles ministériels et des postes de l’Administration. Modifié en 1990, cet article limite désormais le partage intercommunautaire du domaine administratif aux postes de première catégorie et assimilés. S’inscrivant dans une logique de dépassement du confessionnalisme aussi bien politique qu’administratif, ce partage, à son tour, est limité à une “période de transition”.
Sur le partage intercommunautaire des sièges parlementaires, la Constitution, avant la réforme de 1990, restait muette. Ce partage était affaire de loi électorale. En principe, cette loi ne jouit pas de l’intangibilité de la Constitution; elle a subi de nombreuses modifications, grandes et petites; jamais, toutefois, la règle confessionnelle appliquée dans la distribution des sièges n’avait été remise en cause. La réforme constitutionnelle de 1990, elle, ayant instauré la parité, dans la Chambre, des deux communautés religieuses du pays, a, en même temps, réduit cette règle confessionnelle au statut de disposition transitoire. Aussi, a-t-elle confié à la nouvelle Chambre la mission de promulguer une loi électorale libérée de la contrainte confessionnelle.
La “Formule” dispose de deux autres accès à la Constitution. Les articles 9 et 10 garantissent aux communautés le respect de leurs statuts personnels respectifs et de leurs intérêts religieux, aussi bien que le droit de fonder des écoles: garanties qu’on ne peut qualifier d’antidémocratiques. Elles ne signifient nullement, en effet, que les lois sur le statut personnel doivent être exclusivement confessionnelles ni, bien entendu, que la fondation d’écoles est un droit exclusif des communautés confessionnelles.
Cette série de dispositions – explicitement “provisoires” ou “transitoires” ou implicitement non exclusives – reste loin d’altérer fondamentalement l’esprit démocratique de la Constitution. La question étant, cependant, d’évaluer les chances de maintenir la paix civile au sein de l’État dont cette Constitution est supposée informer le gouvernement, l’affirmation du caractère démocratique de ladite Constitution reste loin d’épuiser les éléments de réponse.
Notre État est-il réellement gouverné selon sa Constitution?
La “Formule” consacrée par l’érection des communautés confessionnelles en parties du Pacte est – nous l’avons déjà signalé – quelque chose de bien différent de la Constitution. Elle réagit sur cette dernière, sur le Pacte lui-même, sur la cohérence et l’autonomie de l’État et, partant, sur la paix civile dont elle met en question la longévité. En effet, la “Formule” se mue en amarre de conflits civils qu’elle échoue à prévenir, cet échec polarisant, à son tour, des facteurs de discorde émanant de l’evironnement régional et international; les effets de ces facteurs atteignent le pays pour, de nouveau, se répercuter sur leurs lieux de provenance.
Quels effets la “Formule” exerce-t-elle sur le Pacte d’abord? En réalité, elle le vide de son contenu, en dépit du fait qu’elle tire de lui sa légitimité théorique.
Interdite par le Pacte dont une des parties devait s’abstenir de jamais y avoir recours, la sollicitation d’une protection étrangère a fini par devenir une pratique commune aux deux parties contractantes. Au lieu d’une protection, nous nous sommes trouvés en présence de plusieurs, les deux parties du Pacte étant bien plus que deux, en réalité. Le Pacte gratifiait le Liban d’un rôle unitaire dans l’édification d’une solidarité arabe; or, c’est le recours de parties libanaises à l’appui de telle partie régionale, libanaise ou non, qui a toujours prévalu: recours qui, loin de renforcer la solidarité arabe, a pour effet plausible d’aggraver les dissensions libanaises. Un autre effet coutumier de ce même recours est de saper, partiellement, au moins, les assises de l’État indépendant. À son tour, l’affaiblissement du pouvoir public ne laisse pas de mettre en danger la paix civile. En effet, dans un contexte de dépendances éparses et de réduction du consensus national à son noyau minimal, la possibilité devient grande, dès que le besoin s’en manifeste, d’abattre de l’extérieur cette paix, moyennant la mobilisation d’une réserve intérieure déjà disponible. Pendant la dernière guerre, la polarisation à partir de l’extérieur a revêtu, au fur et à mesure que l’État s’étiolait, des formes flagrantes. Les parties du conflit s’étaient munies de véritables bras diplomatiques; elles avaient, en marge de l’État, de multiples échanges avec les ambassadeurs et s’érigeaient même en partenaires contractuels quasi-indépendants d’États étrangers. Déjà cependant, cette tendance n’était pas propre au temps de guerre; ce temps révolu, elle ne s’est pas entièrement résorbée…
En bref, la “Formule” que le Pacte a renouvelée et consolidée n’a fait que mettre en péril ce que le Pacte avait voulu assurer à l’État: sa souveraineté intérieure et son indépendance vis-à-vis de l’Extérieur. La protection plus ou moins aléatoire de chaque communauté contre le danger d’une marginalisation excessive a pu être maintenue; elle ne se traduisait jamais par un partage raisonnablement équitable du pouvoir et de ses différentes mannes. Plus dangereusement, cette protection ne se maintenait qu’au prix d’une excessive hypothèque pesant à la fois sur la paix interne et sur la sécurité nationale qui, toutes deux, demeuraient exposées à l’humeur instable de la conjoncture environnante. Encore une fois, cette humeur disposait de ressources libanaises faciles à mobiliser et à entretenir. En termes plus pertinents pour notre propos, l’écartement du despotisme monocommunautaire (écartement qui, d’ailleurs, n’exclue pas une dose, variable selon les communautés, de despotisme intra-communautaire) n’a guère débouché sur la mise en évidence d’un intérêt général, autonome par rapport aux commuautés. Obnubilé, cet intérêt n’a pu donner naissance, à son tour, à un Pouvoir public assez détaché des groupes pour se préserver contre la menace de désagrégation tout en se défaisant du besoin de protection étrangère. La gestion et la résolution des conflits travaillant la société libanaise se ressentent toujours de cette déficience de suprématie de l’intérêt général.
Que fait la “Formule” de la Constitution, en deuxième lieu?
La Constitution garantit les droits de l’individu-citoyen; la “Formule”, elle, confisque l’être même de cet être en l’enrôlant, de gré ou de force, dans sa communauté d’origine. Elle le confisque dans le berceau, dans la tombe et dans la substance de l’entre-deux. Ce faisant, elle rétrécit gravement le champ des choix politiques de cet être et celui de ses droits civils; elle lui impose un régime de statut personnel ne correspondant pas nécessairement à ses croyances personnelles. En plus, elle encourage le milieu communautaire qui l’environne à limiter son droit de gérer librement sa vie privée. Ce sont là des limites certaines de la “démocratie” libanaise, envisagée du côté des Droits de l’Homme.
La Constitution stipule la séparation des pouvoirs; la “Formule”, elle, met le chef du pouvoir législatif – quel que soit son nom – dans l’impossibilité de résister, en tant que leader politique d’une communauté, à la tentation de s’immiscer, dans l’intérêt de sa communauté ou des fractions qu’il représente de cette dernière, dans l’exercice du pouvoir exécutif. La formule menace, d’autre part, en placant face à face les deux chefs de l’exécutif, de les engager, en tant que représentants principaux de deux communautés, dans d’interminables tiraillements qui ont pour principal fruit de retarder ou même de geler la solution des problèmes courants ou encore de pousser à un troc de décisions favorisant, tour à tour, chacun des deux Présidents.
Par voie de conséquence, les pouvoirs que – du fait qu’ils sont ceux de l’État national – la Constitution suppose être publics, se trouvent en fait noyautés, partiellement du moins, par des centres d’influence. À chacun de ces centres, échoit la tâche de consolider ou d’élargir l’allégeance communautaire à son chef. Il s’agit là d’une situation qui renforce la propension à étendre le cercle de la distribution symétrique des faveurs, en faisant fi de toute logique d’intérêt général, des limites des ressources de l’État et de l’échelle de priorités de ce dernier. En plus du gaspillage croissant et de la multiplication des faveurs, les travaux sont souvent mal exécutés: le but d’utilité publique qui motive leur réalisation est doublé ou même éclipsé par le dessein de rassasier l’appétit des profiteurs et celui de leurs parrains. Les ressources de l’État constituent, bien entendu, une limite objective – assez élastique, il est vrai – à cette tendance; on en fera donc une estimation plus ou moins irréaliste. Autant du côté de la transparence que de celui de la responsabilité, ces pratiques rétrécissent le champ de la démocratie. Réduisent-elles également les chances de préserver la paix civile? En fait, celle-ci ne peut que se ressentir d’une évetuelle crise générale. Il est probable que, s’apercevant du fait que les limites des ressources publiques ont été depuis longtemps dépassées, seule une minorité exigera une assignation générale des responsabilités. Ceux au profit desquels les bornes ont été déplacées – et ils sont légion! – se livreront probablement à un échange d’accusations, chaque partie s’efforcant d’incriminer ses concurrents – et complices – d’hier. Les lignes de démarcation entre les partenaires étant d’abord confessionnelles, chacun mobilisera pour sa défense, son milieu bien familier. Il s’agit là – c’est le moins qu’on puisse dire – de procédés peu indiqués pour la défense de la paix civile; nous en avons eu, d’ailleurs, il n’y a pas longtemps, un avant-goût.
La parcellisation en symétrie que la “Formule” provoque dans les pouvoirs publics a pour conséquence de rendre suspect de mollesse dans la défense des intérêts de sa propre communauté, tout responsable qui – s’en tenant aux termes de la Constitution – met en avant l’intérêt général dans l’exercice de l’un ou l’autre des pouvoirs publics. Or, c’est là une accusation dont les politiques n’apprécient pas beaucoup la compagnie prolongée. Tel qu’il se révèle à l’imaginaire d’une communauté, l’intérêt communautaire coincide rarement avec l’intérêt général; il en est même souvent l’antithèse. En fait, on exagère à peine en disant que, dans le rêve de son public, l’intérêt d’une communauté consiste à voir tous les écoliers lui appartenant passer brillamment leurs examens, toutes les familles bénéficier de subventions étatiques et la communauté entière jouir d’une exemption totale d’impôts! Aussi, la “Formule” échoue-t-elle à faire cristalliser, dans l’imaginaire communautaire, le Pouvoir d’État en tant qu’Autorité habilitée à rendre ce qu’elle doit et à prendre ce qui lui est dû. Tout au contraire, les droits des particuliers apparaissent au susdit imaginaire comme étant, à la fois, des devoirs de l’État et des faveurs que le Dirigeant de la communauté, toujours en alerte, octroie à celle-ci. Les devoirs des particuliers se muent, de leur côté, en simple corvée que le même Dirigeant est sensé éloigner, autant que faire se peut, des épaules de ses clients. En faisant sienne cette double représentation, le “Responsable” voit sa fonction s’augmenter d’une attribution essentielle: celle de mettre hors jeu les lois qui grignotent nécessairement le pécule des particuliers ou, encore, brident la tendance de ceux-ci à suivre, dans la quête de leurs intérêts, des voies convenables pour eux-mêmes mais non agréées par la Loi. Aussi, les dirigeants se retrouvent-ils, chacun à son poste de responsabilité, devant deux définitions souvent contradictoires de leurs charges respectives: l’une conforme à la Constitution et aux lois et l’autre émanant de la “Formule”. D’une part, ils sont supposés appliquer ou faire appliquer les lois – ou même font oeuvre de législateurs, dans le cas des parlementaires – et de l’autre, ils sont pressés d’oeuvrer pour la neutralisation de ces mêmes lois là où leur application contredit leurs intérêts ou ceux de leurs clients… sans parler de cas où ils sont amenés à s’ériger en protecteurs des contrevenants ou même en promoteurs de l’illégalité.
Sans être nécessairement visible, l’effet de ce type de pratique sur les chances de survie de la paix civile est toujours déterminant. Un loyalisme chancelant à l’État, la non reconnaissance de la suprématie de son autorité par rapport aux pouvoirs privés, qu’ils soient symétriques ou intriqués, la mollesse de l’obédience volontaire à la Loi: autant de facteurs qui ne peuvent qu’affaiblir, en définitive, la capacité que doit posséder l’État de faire barrage à l’escalade libre des conflits divers en oeuvre dans la vie sociale. C’est la fonction proprement étatique d’arbitrage des conflits entre les différents groupes constitutifs de la société et de résorption des crises que traverse celle-ci, qui s’en ressent.
Une “Formule” en panne
Dès le jour de sa promulgation, en 1926, la Constitution a décrété la nécessité pour la “Formule” d’opérer son propre dépassement. C’est aussi ce que supposait la Déclaration ministérielle du premier gouvernement du Liban indépendant: déclaration réputée être le texte qui serre au plus près le contenu du Pacte national. La même hypothèse – nous l’avons déjà signalé – a été reprise, affublée, cette fois, d’un mécanisme de mise à exécution, par l’Accord de Taef et par la Réforme constitutionnelle qui a suivi son adoption, à la fin de la guerre. Cependant, dans le sillage de chacune des trois grandes crises qui ont donné naissance a ces textes, la “Formule” se parait de nouveaux atours, faisant fi de l’impératif constitutionnel et s’empressant de se donner pour éternelle, autrement dit pour éternelle garantie du statu quo. Or – la vie et l’histoire en avaient décidé ainsi – les équilibres réels (démographiques, socio-économiques et politiques) du pays étaient entraînés dans un perpétuel changement. Cette antithèse de la “Formule” immuable et des équilibres mouvants se développait sans arrêt. Considérée sous l’angle de son degré d’adaptation aux changements sociaux, la “Formule” en devenait une formule en panne.
Pas moins qu’hier, la même antithèse continue aujourd’hui à se développer. Afin que la “Formule” s’accommode tant soit peu d’une nouvelle conjoncture, il a fallu attendre, à chaque fois, une guerre mondiale ou une guerre à la fois civile et régionale. Au lieu d’oeuvrer pour son dépassement conformément à la Constitution, on se rue aujourd’hui vers la consolidation de la “Formule”; ses tentacules atteignent de nouvelles sphères de la vie sociale. Ce faisant, on laisse la résorption de l’anthitèse sus-mentionnée aux soins de conjonctures déjà éprouvées: une guerre extérieure semant le trouble dans le pays même ou, à défaut, une guerre civile menée par procuration afin de limiter, pour des parties extérieures, le coût qu’un affrontement direct ne manquerait pas de leur imposer.
Le système libanais offre incontestablement des garanties contre l’exercice, par une communauté du pays, d’une emprise proprement tyrannique sur une autre. Ceci dit, l’exercice d’une certaine dose d’hégémonie ou de domination communautaire n’est jamais exclue. Ce qui l’est, bien au contraire, c’est la possibilité de modifier cet état des choses par des moyens politiques. Le système favorise, au besoin, le recours aux armes pour défendre une hégémonie ou une domination. Au prix d’aliéner l’indépendance, il est susceptible de provoquer – autant pour défendre la domination ou l’hégémonie que pour leur résister – des alliances extérieures symétriques. De plus, il produit un État chancelant, inapte à mobiliser pour sa défense (sinon mollement) les différents groupes constitutifs du pays; pourtant ces derniers ont prouvé leur capacité d’assurer vaillamment leur propre défense contre l’État autant que contre d’autres parties. Il arrive même à tel d’entre eux de combattre, au besoin, (et de battre) une Grande Puissance. Au besoin aussi, ces groupes se battent entre eux, ce qui s’inscrit parfaitement dans la logique du système. Telle a été notre situation hier et telle est-elle aujourd’hui. Il reste vrai, toutefois, que la faculté d’exclure le despotisme intérieur est un avantage immense du système libanais ou – pour être précis – de la “Formule” libanaise. Car, de ce despotisme, nous avons connu, autour de nous, des exemples effroyables. Cet avantage suffit-il pour ranger parmi les démocraties le système libanais? S’agissant ici de l’aptitude de la démocratie à préserver la paix, l’assimilation de la démocratie à la seule exclusion du despotisme voudrait dire, dans le cas qui nous occupe, que la démocratie libanaise, loin de nous prémunir contre le danger de confrontation violente, rend probable cette éventualité et ne cesse de nous en rapprocher. En offrant, par ailleurs, un champ propice à la déstabilisation régionale, notre “Formule” ne contribue guère à l’accroissement des chances de la paix dans la région. Quelle que soit la difficulté de l’avouer, ce mode d’usage régional de notre espace, constitue, bel et bien, pour les États de la région, un motif (entre autres plus souvent évoqués) de tolérer, au Liban, le type d’État dont on vient de brosser la description. Il va sans dire qu’à l’ombre de leur “Formule” souvent qualifiée d’”unique”, les Libanais fournissent le gros du cortège de victimes dans les deux cas de conflits internes et de confrontations régionales et internationales que leur pays ne cesse de connaître.
Le dilemme
Qu’arrive-t-il à chaque fois que quelqu’un s’avise de mettre en lumière ce dilemme qui se déploie entre l’exclusion du despotisme intérieur et l’appel à la guerre civile? Ce qui prépare la guerre civile, ce ne sont pas tellement les prières destinées à soustraire au mauvais oeil la miraculeuse “Formule”. La guerre trouve un terrain propice dans la dissolution du pouvoir public, la corruption structurelle généralisée, l’écartèlement de la société en groupements primaires. Or qu’arrive-t-il lorsqu’on tente d’attirer l’attention générale sur ces réalités? Immanquablement, l’inlassable ronronnement si familier redouble de vigueur. Des perles apprises par coeur sont égrénées: “La démocratie n’est jamais parfaite”, “les sociétés plurales sont exposées à l’instabilité”, nous dit-on; que dire alors de celles condamnées à vivre dans un environnement régional très mouvementé? Nous nous retrouverons, donc – c’est garanti! – gros Jeans comme devant. Or, ce mépris que le discours dominant recèle des lecons de la guerre du Liban, ce refus même de tirer de cette guerre une quelconque lecon, sinon la condamnation des Libanais à attendre, sans broncher, de nouvelles guerres, ne peuvent inspirer, à leur tour, qu’un profond mépris. À partir de la chute de Napoléon, la Suisse a pu traverser les guerres européennes (dont deux guerres mondiales) sans être forcée de rompre l’union qu’elle incarne de la paix intérieure et du pluralisme. La démocratie qui coiffe cette union trouve encore du temps pour organiser des référendums autour des procédés de fabrication du gruyère. La Suisse serait-elle Sirius pour notre “Suisse de l’Orient”? Admettons-le. Mais la Turquie, elle aussi, a traversé deux guerres mondiales dont la première a balayé les “royaumes” des Osmanlis. Elle ne s’en est pas mal sortie, compte tenu du mélange de Hanafites, de Kurdes, d’Alévis, de Grecs-orthodoxes, de Juifs, etc., que présente son paysage humain. Un État laic coiffe cette pluralité; il pratique une démocratie imparfaite (toutes le sont, on vient de le rappeler) et assure une paix civile devenue toute relative au cours de ces dernières années, mais qui reste, de loin, préférable à ce que les Libanais ont enduré. On nous objectera, sans doute, que la Turquie est un pays d’une toute autre taille que le Liban. Et la Jordanie, alors? Elle a des dimensions bien comparables à celles du Liban. Et pourtant, l’État jordanien a réussi à repousser le spectre de la guerre civile, c’est à dire à maintenir la cohérence d’un peuple dont une moitié est d’origine bédouine et l’autre formée de Palestiniens au regard braqué sur la Palestine. Or le Pouvoir se trouvait en butte à des milices qui n’étaient autres que le bras armé de la Révolution palestinienne. Par ailleurs, la Jordanie est située au coeur d’une région que délimitait alors la puissance agressive d’Israel, le regard invariablement coléreux de la Syrie, la démagogie de l’Égypte nassérienne, la duplicité de la politique saoudienne et un Baas irakien impatient d’étendre sur le voisinage l’ombre de ses “augustes” dirigeants. Quand donc les Libanais ont-ils eu à affronter plus dures pressions? Il reste vrai, néanmoins, que le Liban n’est ni la Suisse ni la Turquie ni la Jordanie. Et pourquoi donc devrait-il être autre que lui-même pour se pencher sur le dilemme qui joint son passé à son avenir?
De l’import-export
Ce qui précède peut aider à aborder, à partir du cas libanais, une autre question dont les deux cas afghan et irakien ont renouvelé l’actualité. C’est la question de l’exportation de la démocratie. Nous l’approchons en gardant à l’oeil le rapport – qui nous préoccupe ici – de la démocratie aux conditions de sauvegarde de la paix civile. Pour devenir exportable, la démocratie se doit de se réduire à un régime de gouvernement et à un système de lois. En effet, l’attente de l’importateur risquerait de s’avérer trop longue si le colis devait contenir aussi une culture et un modèle de société. La démocratie réduite s’exporte dans des pays dont les structures sociales de base, avec leur train de spécificités, restent l’objet de l’ignorance souveraine des exportateurs mondiaux. Or la question des caractéristiques que présentent les formations primaires d’une société, celle du mode de traitement des rapports de ces formations avec les formations secondaires dont la démocratie requiert l’existence, celle de la création même (et de la consolidation) de ces formations secondaires là où elles manquent à l’appel, convergent pour constituer une seule et même question. Et c’est bien cette question que les sociétés auxquelles on demande de devenir démocratiques sont obligées de se poser. Il s’agit là d’une question bien plus urgente que celle du rapport entre la démocratie et le développement. Ce qui, bien entendu, ne diminue en rien la nécessité de déterminer la mesure dans laquelle le développement constitue une voie – qui, certes, n’est ni sûre ni unique – vers l’aménagement d’une assise de la démocratie. On ne peut oublier, d’autre part, que la démocratie s’exporte, de nos jours, dans les bagages du néo-libéralisme. Or, en détrônant l’État-Providence dans des pays qui sont encore dépourvus de “sociétés civiles” convenablement structurées et disposant de ressources passablement suffisantes pour faire face aux charges que l’État laisse derrière lui en se retirant de l’arène sociale, le néo-libéralisme réduit les plus faibles (et une partie des moins faibles) à la nécessité de se débattre, pieds et poings liés, cette fois, dans l’inextricable filet de la misère. En effet, la structure même de l’État, dans ces pays, le fossé qui les sépare de l’État de droit, constituent un gagne-pain pour une multitude considérable qui jouit, par ce biais, d’une sécurité garantie tantôt par la Loi et tantôt par le laxisme de cette dernière et la possibilité couramment offerte de la détourner. Au Liban, par exemple, une masse de gens bénéficie, en plus de la sécurité sociale légale, de l’inflation des administrations étatiques, d’une sécurité pratiquement absolue de l’emploi et de pensions maquillées en subventions à la production ou en compensations de dégâts. Une partie de cette masse monnayent des parcelles, d’inégale importance, d’influence politique ou administrative contre des pots de vin ou des rackets. D’autres encore vivotent en pratiquant des professions illégales ou en outrepassant les conditions légales requises pour s’adonner à d’autres métiers ou occupations.
Au Liban, également, le secteur associatif offre au regard un essaim impressionnant d’associations entretenues par la société traditionnelle, c’est-à-dire par des communautés familiales, villageoises, confessionnelles, etc. Ces associations sont très souvent entretenues grâce à la mobilisation, rarement exempte de confessionnalisme, de communautés d’émigrés. Elles bénéficient également de l’appui d’États étrangers, proches ou lointains, pour lesquels le critère confessionnel compte également. Last but not least, elles échangent un soutien réciproque avec des personnages influents du milieu politique libanais. Tous cas qui se croisent pour former un tissu compliqué. Et c’est ce tissu dont la cohérence est assurée par la protection politique et le trafic d’influence, que menace de défaire le néo-libéralisme et l’État de droit. Car même l’émigré qui veut faire un don à une école dépendante d’une société de bienfaisance, s’adresse de préférence, à un parrain influent, susceptible de récompenser, un jour, son geste, ou dont la promotion parait indiscernable de celle de sa communauté et des institutions qui font la fierté de celle-ci. Les associations laiques ou assimilées, elles, restent en deca de leurs homologues traditionnelles, en nombre et en moyens. Quand elles ne sont pas carrément étrangères, elles demeurent plus ou moins handicapées par leur dépendance du financement étranger ou international. Qu’offre alors pour faire face à cet état de misère déguisé en sécurité, un néo-libéralisme déguisé en État de droit et ennemi de l’État-providence? Qu’a-t-il prévu pour préserver, là où il vient camper, la paix civile et tout ce qui dépend de son maintien? Se contentera-t-il de regarder d’un mauvais oeil les fonctionnaires corrompus au chômage, les malades chassés du paradis de l’assurance-maladie, le écoliers mis au ban des écoles, les familles privées de l’eau courante et de l’énergie gratuites, les cultivateurs de tabac nostalgiques des subventions de naguère…? Donnera-t-il à l’État de droit, après avoir promené son regard de feu sur ces nuées de sauterelles humaines, l’ordre d’arrêter tout terroriste déguisé en sauterelle? Ou bien, laissera-t-il ceux qui, hier encore, parasitait la société à partir de postes étatiques et l’État à partir de positions sociales, revenir à la charge en parasitant (en bons maffieux) la société à partir de positions sociales pour, de nouveau, investir les rouages étatiques? Et sinon, laissera-t-il aux destinataires de son appareil légal d’exportation, un répit pour méditer sur les conditions de préservation de leur paix civile et le loisir de les assurer?
Ce disant, nous n’ignorons guère que la démocratie, pour se développer, a besoin de lois et d’institutions et que nul n’est autorisé à dénigrer les garanties légales des libertés et la prévention de la tyrannie par la force de la Loi. Nous croyons cependant que l’instauration d’une démocratie authentique, compatible avec le maintien de la paix civile et la préservation, par voie de conséquence, de tout ce qui en dépend (c’est-à-dire, entre autres, de la démocratie elle-même) est une tâche que les dispositions légales restent loin d’épuiser; son accomplissement n’est point affaire d’import-export, en dépit du fait qu’avec le respect de délais temporels appropriés, des relations favorables avec l’environnement régional et mondial aident considérablement à bien s’en acquitter. En 1926, les Francais ont importé, pour notre compte, une Constitution dont on ne peut, en toute équité, que saluer le caractère éminemment démocratique. Ils l’ont importée de France, de Belgique et d’Égypte. Ce qui précède n’est que le sommaire de ce qu’en 77 ans, nous avons fait de cette Constitution. Sous l’effet de facteurs – dont nous encourons, pour l’essentiel, la responsabilité – nous n’avons pu avoir ni beaucoup de paix ni beaucoup de démocratie. Plus grave encore, en ce temps présent, est de constater que nous n’avons assuré ni plus de démocratie ni plus de paix pour les temps à venir.
*****
Ce pays est le seul que j’ai; ma loyauté ne va à nul autre. Le fait de me retrouver beaucoup moins attaché à ce qu’on appelle la “Formule” libanaise que le Président Mohammad Khatami remplit mon coeur de tristesse. Ce n’est pas une raison pour m’en excuser.
* Communication faite à la conférence sur Démocratie et Paix, organisée par la Commision internationale de l'Unesco pour la Paix et le Développement, la Section de la Philosophie et des Sciences humaines à l'Unesco (Paris) et le Centre International des Sciences de l'Homme (Byblos, Liban) et réunie à Beyrouth les 2 et 3 juin 2003.
(Texte traduit de l’arabe par l’auteur en juillet-août 2003)
Le Liban confessionnaliste entre démocratie et paix∗
Par Ahmad Beydoun
D’emblée, j’exclue l’éventualité de m’engager dans un débat purement théorique avec l’analyse si conséquente que met sous nos yeux Alain Caillé. La cohérence même de cette analyse me porte déjà à éviter la confrontation; peut-être, d’ailleurs, ne suis-je pas qualifié pour m’engager dans pareille voie.
Aussi ai-je préféré examiner la possibilité pour l’expérience libanaise de contribuer à l’élaboration d’une réponse à l’interrogation formulée par Caillé: la démocratie fait-elle preuve d’une aptitude particulière à prévenir les conflits?
Dans le cas d’espèce, les conflits visés sont, bien évidemment, des conflits à dominante interne. À travers le cas libanais, nous examinons donc la contribution que l’alternative démocratique peut (ou ne peut pas) apporter à la sauvegarde de la paix civile. Les lecons du cas libanais débordent largement, en fait, les limites de ce pays. Le Liban a connu des conflits pluridimensionnels dont le dernier a été le plus durable et le plus destructeur. Ce conflit s’est inséré dans une confrontation régionale dont certaines parties étaient déjà actives sur le sol même du Liban, alors que d’autres sont intervenues de l’extérieur. La confrontation régionale s’est également dotée, dans son expression libanaise, d’une dimension internationale certaine; à tel point que des forces internationales se sont directement engagées dans le pays, sous prétexte de mettre fin aux affrontements, et qu’elles y ont été prises pour cible par des forces adverses présentes sur le terrain. Une guerre de résistance à l’occupation se poursuivait encore, longtemps après le reflux des affrontements civils. De cette dernière guerre, certains effets à caractère régional ou international, continuent, avec leur train de potentialités néfastes, à peser lourdement sur le pays. Plus généralement, le conflit libanais, tant qu’il durait, comptait parmi les arènes de la lutte entre les Grandes Puissances de l’époque.
Dans le cas qui nous occupe, la question des rapports entre paix civile et démocratie recèle, en principe, une autre question: celle relative aux effets qu’exerce un type particulier de “démocratie” (celui que ce pays a fait sien) sur les chances dont la réalisation d’une paix régionale (affublée, bien entendu, de prolongements internationaux) peut être créditées.
Le choix de dérouler notre analyse dans l’espace libanais répond également à un autre besoin: celui de mettre en évidence la base sociale que présuppose l’édification d’une démocratie. C’est là une question qui – nonobstant la possibilité de vérifier la thèse du conditionnement de la démocratisation par le développement économique – déborde largement celle de la détermination du degré de développement économique que la mise en place d’une démocratie requerrait. Notre problématique a plutôt trait à la nature des formations sociales prépondérantes dans l’espace public. Or des facteurs analogues favorisant cette prépondérance peuvent se retrouver dans des sociétés riches et dans d’autres bien démunis. Nous mettons donc en question la possibilité d’imposer la démocratie par la seule force des lois adéquates. Et déjà la possibilité d’importer d’outre mer la démocratie – en vue, par exemple, d’obéir, sur le champ, à un diktat étranger – nous semble bien douteuse.
Trois piliers
Au Liban, les évaluations, positives ou négatives, des comportements politiques s’énoncent, en général, à partir de trois corpus normatifs: la Constitution, le Pacte National et ce qu’on appelle la “Formule” libanaise. Notre traitement de la question que nous venons de poser visera à cerner le réseau de relations que l’histoire contemporaine du Liban a tissé entre ces trois hypostases. Et si nous ne retenons pas l’Accord de Taef comme quatrième pilier de cet édifice, ce n’est guère méconnaissance de la valeur d’un texte qui a ménagé aux Libanais une sortie de la guerre; notre attitude se prévaut, bien plutôt, d’un diagnostic précis des rapports que cet Accord a pu entretenir, dans son élaboration et, plus tard, dans son application, avec les éléments de la susdite triade. En effet, nous pensons que, de par sa prévision d’une phase transitoire dont il a esquissé les traits, cet Accord a représenté un amendement, d’ailleurs rendu inévitable par les changements objectifs qu’a enregistrés l’histoire du Liban indépendant, de la formule libanaise. Il a représenté également un rééquilibrage de deux déclarations de principe que le Pacte avait mises l’une en regard de l’autre et que nous aborderons sous peu. Enfin, l’Accord de Taef a prévu, pour le système libanais, un nouvel état de fait que ce dernier devait atteindre à travers la phase transitoire: état de fait qui devait culminer, du côté de la “Formule”, en la déconfessionnalisation du régime politique et, du côté du Pacte, en l’évacuation du territoire libanais par les Forces armées syriennes. Ces deux conditions n’ayant pas été remplies, l’amendement de la “Formule” tend à se muer en scandale, et celui du Pacte, en assimilation de ce dernier à une simple imposture. Par ailleurs, le procès de réforme constitutionnelle consigné dans l’Accord n’a pu se traduire par l’amélioration de la Constitution qu’il laissait espérer. Ayant fait un premier pas avant de se figer, cette réforme s’est vite vouée à la corruption. L’interprétation unilatérale des clauses de la réforme, son isolement de l’ambiance consensuelle où l’Accord la voulait incluse, ne pouvaient qu’ en accélérer la dégénérescence. Ce qui devait initier une marche en avant, s’est trouvé réduit, en définitive, à un faux pas. Nous en sommes toujours là.
Si donc nous faisions du Pacte national le point de départ de notre analyse, force nous serait de reconnaître que le contenu explicite de ce Pacte reste muet sur la forme – démocratique ou autre – du régime politique. Le Pacte national – rappelons-le – est la dénomination courante de l’entente scellée, à la veille de l’Indépendance du Liban, entre le premier Président de la République émancipée et son premier Président du Conseil. Explicitement, il stipule l’engagement d’une partie des Libanais à abandonner la revendication de l’Unité arabe (ou syrienne) en échange de l’engagement de l’autre partie à s’abstenir de solliciter une protection étrangère. Cependant, le Pacte, en tant que contrat, sous-entend l’érection des parties contractantes en membres fondateurs de l’État indépendant. D’entrée de jeu, il est entendu que ces parties ne sont autres que les communautés confessionnelles du pays. Cette institution des communautés en parties exclusives de la fondation de l’État indépendant se fait sous la couverture d’une autorité autre que que celle du pacte (et que celle de la Constitution que nous aborderons incessamment); cette autorité est celle de la fameuse “Formule” libanaise qui, considérée dans la dimension temporelle, est antérieure à la Constitution et au Pacte.
La Constitution, elle, se situe, quant à ses prémisses, bien à l’écart du modèle confessionnaliste. Elle instaure une République parlementaire “normale” dotée d’une Chambre élue pour une durée déterminée, d’un Gouvernement se prévalant, dans l’exercice de son pouvoir, de la confiance de la Chambre, d’un Président de la République élu par la Chambre et dont le mandat ne peut être reconduit. À la suite, surtout, des amendements de 1990, les prérogatives de ce Président se trouvent être strictement délimitées autant par les dispositions précises qui les définissent que par l’autorité d’institutions dont la principale est le Conseil des Ministres; le Président de ce Conseil est désigné en conformité aux résultats de consultations parlementaires impératives auxquelles procède le Président de la République. Ce dernier n’a pas de pouvoir direct sur l’Administration publique ni sur les Forces armées, ni, bien entendu, sur le corps judiciaire. Sur un autre plan, la Constitution garantit l’égalité de tous devant la Loi, les libertés publiques fondamentales, les droits des personnes et les libertés individuelles. Le système – tout cela porte à l’admettre – remplit les conditions principales de la démocratie: les libertés publiques et privées garanties, l’alternance au pouvoir, la fonction législative assurée par l’Assemblée élue et la nécessité pour l’Exécutif de rendre compte à celle-ci, le contrôle gouvernemental sur l’Administration par l’entremise de corps spécialisés et dans les limites de la Loi, la soumission des corps militaires et de sécurité à l’Autorité politique… sans oublier l’encouragement donné à l’initiative individuelle et à l’entreprise privée, dans la sphère économique, etc. Des carences des garanties juridiques de l’indépendance de la justice, de même que de la transparence du fonctionnement de l’État et de ses appareils, sont souvent soulignées; elles ne remettent pas en question la dominance certaine de l’orientation démocratique dans la Constitution libanaise.
Il en va de même de l’existence, dans le texte de la Constitution, d’accès limitées concédées à l’esprit confessionnaliste. L’énoncé originel de l’article 95 stipulait le partage entre les communautés, “provisoirement et dans un esprit d’équité et de justice”, des portefeuilles ministériels et des postes de l’Administration. Modifié en 1990, cet article limite désormais le partage intercommunautaire du domaine administratif aux postes de première catégorie et assimilés. S’inscrivant dans une logique de dépassement du confessionnalisme aussi bien politique qu’administratif, ce partage, à son tour, est limité à une “période de transition”.
Sur le partage intercommunautaire des sièges parlementaires, la Constitution, avant la réforme de 1990, restait muette. Ce partage était affaire de loi électorale. En principe, cette loi ne jouit pas de l’intangibilité de la Constitution; elle a subi de nombreuses modifications, grandes et petites; jamais, toutefois, la règle confessionnelle appliquée dans la distribution des sièges n’avait été remise en cause. La réforme constitutionnelle de 1990, elle, ayant instauré la parité, dans la Chambre, des deux communautés religieuses du pays, a, en même temps, réduit cette règle confessionnelle au statut de disposition transitoire. Aussi, a-t-elle confié à la nouvelle Chambre la mission de promulguer une loi électorale libérée de la contrainte confessionnelle.
La “Formule” dispose de deux autres accès à la Constitution. Les articles 9 et 10 garantissent aux communautés le respect de leurs statuts personnels respectifs et de leurs intérêts religieux, aussi bien que le droit de fonder des écoles: garanties qu’on ne peut qualifier d’antidémocratiques. Elles ne signifient nullement, en effet, que les lois sur le statut personnel doivent être exclusivement confessionnelles ni, bien entendu, que la fondation d’écoles est un droit exclusif des communautés confessionnelles.
Cette série de dispositions – explicitement “provisoires” ou “transitoires” ou implicitement non exclusives – reste loin d’altérer fondamentalement l’esprit démocratique de la Constitution. La question étant, cependant, d’évaluer les chances de maintenir la paix civile au sein de l’État dont cette Constitution est supposée informer le gouvernement, l’affirmation du caractère démocratique de ladite Constitution reste loin d’épuiser les éléments de réponse.
Notre État est-il réellement gouverné selon sa Constitution?
La “Formule” consacrée par l’érection des communautés confessionnelles en parties du Pacte est – nous l’avons déjà signalé – quelque chose de bien différent de la Constitution. Elle réagit sur cette dernière, sur le Pacte lui-même, sur la cohérence et l’autonomie de l’État et, partant, sur la paix civile dont elle met en question la longévité. En effet, la “Formule” se mue en amarre de conflits civils qu’elle échoue à prévenir, cet échec polarisant, à son tour, des facteurs de discorde émanant de l’evironnement régional et international; les effets de ces facteurs atteignent le pays pour, de nouveau, se répercuter sur leurs lieux de provenance.
Quels effets la “Formule” exerce-t-elle sur le Pacte d’abord? En réalité, elle le vide de son contenu, en dépit du fait qu’elle tire de lui sa légitimité théorique.
Interdite par le Pacte dont une des parties devait s’abstenir de jamais y avoir recours, la sollicitation d’une protection étrangère a fini par devenir une pratique commune aux deux parties contractantes. Au lieu d’une protection, nous nous sommes trouvés en présence de plusieurs, les deux parties du Pacte étant bien plus que deux, en réalité. Le Pacte gratifiait le Liban d’un rôle unitaire dans l’édification d’une solidarité arabe; or, c’est le recours de parties libanaises à l’appui de telle partie régionale, libanaise ou non, qui a toujours prévalu: recours qui, loin de renforcer la solidarité arabe, a pour effet plausible d’aggraver les dissensions libanaises. Un autre effet coutumier de ce même recours est de saper, partiellement, au moins, les assises de l’État indépendant. À son tour, l’affaiblissement du pouvoir public ne laisse pas de mettre en danger la paix civile. En effet, dans un contexte de dépendances éparses et de réduction du consensus national à son noyau minimal, la possibilité devient grande, dès que le besoin s’en manifeste, d’abattre de l’extérieur cette paix, moyennant la mobilisation d’une réserve intérieure déjà disponible. Pendant la dernière guerre, la polarisation à partir de l’extérieur a revêtu, au fur et à mesure que l’État s’étiolait, des formes flagrantes. Les parties du conflit s’étaient munies de véritables bras diplomatiques; elles avaient, en marge de l’État, de multiples échanges avec les ambassadeurs et s’érigeaient même en partenaires contractuels quasi-indépendants d’États étrangers. Déjà cependant, cette tendance n’était pas propre au temps de guerre; ce temps révolu, elle ne s’est pas entièrement résorbée…
En bref, la “Formule” que le Pacte a renouvelée et consolidée n’a fait que mettre en péril ce que le Pacte avait voulu assurer à l’État: sa souveraineté intérieure et son indépendance vis-à-vis de l’Extérieur. La protection plus ou moins aléatoire de chaque communauté contre le danger d’une marginalisation excessive a pu être maintenue; elle ne se traduisait jamais par un partage raisonnablement équitable du pouvoir et de ses différentes mannes. Plus dangereusement, cette protection ne se maintenait qu’au prix d’une excessive hypothèque pesant à la fois sur la paix interne et sur la sécurité nationale qui, toutes deux, demeuraient exposées à l’humeur instable de la conjoncture environnante. Encore une fois, cette humeur disposait de ressources libanaises faciles à mobiliser et à entretenir. En termes plus pertinents pour notre propos, l’écartement du despotisme monocommunautaire (écartement qui, d’ailleurs, n’exclue pas une dose, variable selon les communautés, de despotisme intra-communautaire) n’a guère débouché sur la mise en évidence d’un intérêt général, autonome par rapport aux commuautés. Obnubilé, cet intérêt n’a pu donner naissance, à son tour, à un Pouvoir public assez détaché des groupes pour se préserver contre la menace de désagrégation tout en se défaisant du besoin de protection étrangère. La gestion et la résolution des conflits travaillant la société libanaise se ressentent toujours de cette déficience de suprématie de l’intérêt général.
Que fait la “Formule” de la Constitution, en deuxième lieu?
La Constitution garantit les droits de l’individu-citoyen; la “Formule”, elle, confisque l’être même de cet être en l’enrôlant, de gré ou de force, dans sa communauté d’origine. Elle le confisque dans le berceau, dans la tombe et dans la substance de l’entre-deux. Ce faisant, elle rétrécit gravement le champ des choix politiques de cet être et celui de ses droits civils; elle lui impose un régime de statut personnel ne correspondant pas nécessairement à ses croyances personnelles. En plus, elle encourage le milieu communautaire qui l’environne à limiter son droit de gérer librement sa vie privée. Ce sont là des limites certaines de la “démocratie” libanaise, envisagée du côté des Droits de l’Homme.
La Constitution stipule la séparation des pouvoirs; la “Formule”, elle, met le chef du pouvoir législatif – quel que soit son nom – dans l’impossibilité de résister, en tant que leader politique d’une communauté, à la tentation de s’immiscer, dans l’intérêt de sa communauté ou des fractions qu’il représente de cette dernière, dans l’exercice du pouvoir exécutif. La formule menace, d’autre part, en placant face à face les deux chefs de l’exécutif, de les engager, en tant que représentants principaux de deux communautés, dans d’interminables tiraillements qui ont pour principal fruit de retarder ou même de geler la solution des problèmes courants ou encore de pousser à un troc de décisions favorisant, tour à tour, chacun des deux Présidents.
Par voie de conséquence, les pouvoirs que – du fait qu’ils sont ceux de l’État national – la Constitution suppose être publics, se trouvent en fait noyautés, partiellement du moins, par des centres d’influence. À chacun de ces centres, échoit la tâche de consolider ou d’élargir l’allégeance communautaire à son chef. Il s’agit là d’une situation qui renforce la propension à étendre le cercle de la distribution symétrique des faveurs, en faisant fi de toute logique d’intérêt général, des limites des ressources de l’État et de l’échelle de priorités de ce dernier. En plus du gaspillage croissant et de la multiplication des faveurs, les travaux sont souvent mal exécutés: le but d’utilité publique qui motive leur réalisation est doublé ou même éclipsé par le dessein de rassasier l’appétit des profiteurs et celui de leurs parrains. Les ressources de l’État constituent, bien entendu, une limite objective – assez élastique, il est vrai – à cette tendance; on en fera donc une estimation plus ou moins irréaliste. Autant du côté de la transparence que de celui de la responsabilité, ces pratiques rétrécissent le champ de la démocratie. Réduisent-elles également les chances de préserver la paix civile? En fait, celle-ci ne peut que se ressentir d’une évetuelle crise générale. Il est probable que, s’apercevant du fait que les limites des ressources publiques ont été depuis longtemps dépassées, seule une minorité exigera une assignation générale des responsabilités. Ceux au profit desquels les bornes ont été déplacées – et ils sont légion! – se livreront probablement à un échange d’accusations, chaque partie s’efforcant d’incriminer ses concurrents – et complices – d’hier. Les lignes de démarcation entre les partenaires étant d’abord confessionnelles, chacun mobilisera pour sa défense, son milieu bien familier. Il s’agit là – c’est le moins qu’on puisse dire – de procédés peu indiqués pour la défense de la paix civile; nous en avons eu, d’ailleurs, il n’y a pas longtemps, un avant-goût.
La parcellisation en symétrie que la “Formule” provoque dans les pouvoirs publics a pour conséquence de rendre suspect de mollesse dans la défense des intérêts de sa propre communauté, tout responsable qui – s’en tenant aux termes de la Constitution – met en avant l’intérêt général dans l’exercice de l’un ou l’autre des pouvoirs publics. Or, c’est là une accusation dont les politiques n’apprécient pas beaucoup la compagnie prolongée. Tel qu’il se révèle à l’imaginaire d’une communauté, l’intérêt communautaire coincide rarement avec l’intérêt général; il en est même souvent l’antithèse. En fait, on exagère à peine en disant que, dans le rêve de son public, l’intérêt d’une communauté consiste à voir tous les écoliers lui appartenant passer brillamment leurs examens, toutes les familles bénéficier de subventions étatiques et la communauté entière jouir d’une exemption totale d’impôts! Aussi, la “Formule” échoue-t-elle à faire cristalliser, dans l’imaginaire communautaire, le Pouvoir d’État en tant qu’Autorité habilitée à rendre ce qu’elle doit et à prendre ce qui lui est dû. Tout au contraire, les droits des particuliers apparaissent au susdit imaginaire comme étant, à la fois, des devoirs de l’État et des faveurs que le Dirigeant de la communauté, toujours en alerte, octroie à celle-ci. Les devoirs des particuliers se muent, de leur côté, en simple corvée que le même Dirigeant est sensé éloigner, autant que faire se peut, des épaules de ses clients. En faisant sienne cette double représentation, le “Responsable” voit sa fonction s’augmenter d’une attribution essentielle: celle de mettre hors jeu les lois qui grignotent nécessairement le pécule des particuliers ou, encore, brident la tendance de ceux-ci à suivre, dans la quête de leurs intérêts, des voies convenables pour eux-mêmes mais non agréées par la Loi. Aussi, les dirigeants se retrouvent-ils, chacun à son poste de responsabilité, devant deux définitions souvent contradictoires de leurs charges respectives: l’une conforme à la Constitution et aux lois et l’autre émanant de la “Formule”. D’une part, ils sont supposés appliquer ou faire appliquer les lois – ou même font oeuvre de législateurs, dans le cas des parlementaires – et de l’autre, ils sont pressés d’oeuvrer pour la neutralisation de ces mêmes lois là où leur application contredit leurs intérêts ou ceux de leurs clients… sans parler de cas où ils sont amenés à s’ériger en protecteurs des contrevenants ou même en promoteurs de l’illégalité.
Sans être nécessairement visible, l’effet de ce type de pratique sur les chances de survie de la paix civile est toujours déterminant. Un loyalisme chancelant à l’État, la non reconnaissance de la suprématie de son autorité par rapport aux pouvoirs privés, qu’ils soient symétriques ou intriqués, la mollesse de l’obédience volontaire à la Loi: autant de facteurs qui ne peuvent qu’affaiblir, en définitive, la capacité que doit posséder l’État de faire barrage à l’escalade libre des conflits divers en oeuvre dans la vie sociale. C’est la fonction proprement étatique d’arbitrage des conflits entre les différents groupes constitutifs de la société et de résorption des crises que traverse celle-ci, qui s’en ressent.
Une “Formule” en panne
Dès le jour de sa promulgation, en 1926, la Constitution a décrété la nécessité pour la “Formule” d’opérer son propre dépassement. C’est aussi ce que supposait la Déclaration ministérielle du premier gouvernement du Liban indépendant: déclaration réputée être le texte qui serre au plus près le contenu du Pacte national. La même hypothèse – nous l’avons déjà signalé – a été reprise, affublée, cette fois, d’un mécanisme de mise à exécution, par l’Accord de Taef et par la Réforme constitutionnelle qui a suivi son adoption, à la fin de la guerre. Cependant, dans le sillage de chacune des trois grandes crises qui ont donné naissance a ces textes, la “Formule” se parait de nouveaux atours, faisant fi de l’impératif constitutionnel et s’empressant de se donner pour éternelle, autrement dit pour éternelle garantie du statu quo. Or – la vie et l’histoire en avaient décidé ainsi – les équilibres réels (démographiques, socio-économiques et politiques) du pays étaient entraînés dans un perpétuel changement. Cette antithèse de la “Formule” immuable et des équilibres mouvants se développait sans arrêt. Considérée sous l’angle de son degré d’adaptation aux changements sociaux, la “Formule” en devenait une formule en panne.
Pas moins qu’hier, la même antithèse continue aujourd’hui à se développer. Afin que la “Formule” s’accommode tant soit peu d’une nouvelle conjoncture, il a fallu attendre, à chaque fois, une guerre mondiale ou une guerre à la fois civile et régionale. Au lieu d’oeuvrer pour son dépassement conformément à la Constitution, on se rue aujourd’hui vers la consolidation de la “Formule”; ses tentacules atteignent de nouvelles sphères de la vie sociale. Ce faisant, on laisse la résorption de l’anthitèse sus-mentionnée aux soins de conjonctures déjà éprouvées: une guerre extérieure semant le trouble dans le pays même ou, à défaut, une guerre civile menée par procuration afin de limiter, pour des parties extérieures, le coût qu’un affrontement direct ne manquerait pas de leur imposer.
Le système libanais offre incontestablement des garanties contre l’exercice, par une communauté du pays, d’une emprise proprement tyrannique sur une autre. Ceci dit, l’exercice d’une certaine dose d’hégémonie ou de domination communautaire n’est jamais exclue. Ce qui l’est, bien au contraire, c’est la possibilité de modifier cet état des choses par des moyens politiques. Le système favorise, au besoin, le recours aux armes pour défendre une hégémonie ou une domination. Au prix d’aliéner l’indépendance, il est susceptible de provoquer – autant pour défendre la domination ou l’hégémonie que pour leur résister – des alliances extérieures symétriques. De plus, il produit un État chancelant, inapte à mobiliser pour sa défense (sinon mollement) les différents groupes constitutifs du pays; pourtant ces derniers ont prouvé leur capacité d’assurer vaillamment leur propre défense contre l’État autant que contre d’autres parties. Il arrive même à tel d’entre eux de combattre, au besoin, (et de battre) une Grande Puissance. Au besoin aussi, ces groupes se battent entre eux, ce qui s’inscrit parfaitement dans la logique du système. Telle a été notre situation hier et telle est-elle aujourd’hui. Il reste vrai, toutefois, que la faculté d’exclure le despotisme intérieur est un avantage immense du système libanais ou – pour être précis – de la “Formule” libanaise. Car, de ce despotisme, nous avons connu, autour de nous, des exemples effroyables. Cet avantage suffit-il pour ranger parmi les démocraties le système libanais? S’agissant ici de l’aptitude de la démocratie à préserver la paix, l’assimilation de la démocratie à la seule exclusion du despotisme voudrait dire, dans le cas qui nous occupe, que la démocratie libanaise, loin de nous prémunir contre le danger de confrontation violente, rend probable cette éventualité et ne cesse de nous en rapprocher. En offrant, par ailleurs, un champ propice à la déstabilisation régionale, notre “Formule” ne contribue guère à l’accroissement des chances de la paix dans la région. Quelle que soit la difficulté de l’avouer, ce mode d’usage régional de notre espace, constitue, bel et bien, pour les États de la région, un motif (entre autres plus souvent évoqués) de tolérer, au Liban, le type d’État dont on vient de brosser la description. Il va sans dire qu’à l’ombre de leur “Formule” souvent qualifiée d’”unique”, les Libanais fournissent le gros du cortège de victimes dans les deux cas de conflits internes et de confrontations régionales et internationales que leur pays ne cesse de connaître.
Le dilemme
Qu’arrive-t-il à chaque fois que quelqu’un s’avise de mettre en lumière ce dilemme qui se déploie entre l’exclusion du despotisme intérieur et l’appel à la guerre civile? Ce qui prépare la guerre civile, ce ne sont pas tellement les prières destinées à soustraire au mauvais oeil la miraculeuse “Formule”. La guerre trouve un terrain propice dans la dissolution du pouvoir public, la corruption structurelle généralisée, l’écartèlement de la société en groupements primaires. Or qu’arrive-t-il lorsqu’on tente d’attirer l’attention générale sur ces réalités? Immanquablement, l’inlassable ronronnement si familier redouble de vigueur. Des perles apprises par coeur sont égrénées: “La démocratie n’est jamais parfaite”, “les sociétés plurales sont exposées à l’instabilité”, nous dit-on; que dire alors de celles condamnées à vivre dans un environnement régional très mouvementé? Nous nous retrouverons, donc – c’est garanti! – gros Jeans comme devant. Or, ce mépris que le discours dominant recèle des lecons de la guerre du Liban, ce refus même de tirer de cette guerre une quelconque lecon, sinon la condamnation des Libanais à attendre, sans broncher, de nouvelles guerres, ne peuvent inspirer, à leur tour, qu’un profond mépris. À partir de la chute de Napoléon, la Suisse a pu traverser les guerres européennes (dont deux guerres mondiales) sans être forcée de rompre l’union qu’elle incarne de la paix intérieure et du pluralisme. La démocratie qui coiffe cette union trouve encore du temps pour organiser des référendums autour des procédés de fabrication du gruyère. La Suisse serait-elle Sirius pour notre “Suisse de l’Orient”? Admettons-le. Mais la Turquie, elle aussi, a traversé deux guerres mondiales dont la première a balayé les “royaumes” des Osmanlis. Elle ne s’en est pas mal sortie, compte tenu du mélange de Hanafites, de Kurdes, d’Alévis, de Grecs-orthodoxes, de Juifs, etc., que présente son paysage humain. Un État laic coiffe cette pluralité; il pratique une démocratie imparfaite (toutes le sont, on vient de le rappeler) et assure une paix civile devenue toute relative au cours de ces dernières années, mais qui reste, de loin, préférable à ce que les Libanais ont enduré. On nous objectera, sans doute, que la Turquie est un pays d’une toute autre taille que le Liban. Et la Jordanie, alors? Elle a des dimensions bien comparables à celles du Liban. Et pourtant, l’État jordanien a réussi à repousser le spectre de la guerre civile, c’est à dire à maintenir la cohérence d’un peuple dont une moitié est d’origine bédouine et l’autre formée de Palestiniens au regard braqué sur la Palestine. Or le Pouvoir se trouvait en butte à des milices qui n’étaient autres que le bras armé de la Révolution palestinienne. Par ailleurs, la Jordanie est située au coeur d’une région que délimitait alors la puissance agressive d’Israel, le regard invariablement coléreux de la Syrie, la démagogie de l’Égypte nassérienne, la duplicité de la politique saoudienne et un Baas irakien impatient d’étendre sur le voisinage l’ombre de ses “augustes” dirigeants. Quand donc les Libanais ont-ils eu à affronter plus dures pressions? Il reste vrai, néanmoins, que le Liban n’est ni la Suisse ni la Turquie ni la Jordanie. Et pourquoi donc devrait-il être autre que lui-même pour se pencher sur le dilemme qui joint son passé à son avenir?
De l’import-export
Ce qui précède peut aider à aborder, à partir du cas libanais, une autre question dont les deux cas afghan et irakien ont renouvelé l’actualité. C’est la question de l’exportation de la démocratie. Nous l’approchons en gardant à l’oeil le rapport – qui nous préoccupe ici – de la démocratie aux conditions de sauvegarde de la paix civile. Pour devenir exportable, la démocratie se doit de se réduire à un régime de gouvernement et à un système de lois. En effet, l’attente de l’importateur risquerait de s’avérer trop longue si le colis devait contenir aussi une culture et un modèle de société. La démocratie réduite s’exporte dans des pays dont les structures sociales de base, avec leur train de spécificités, restent l’objet de l’ignorance souveraine des exportateurs mondiaux. Or la question des caractéristiques que présentent les formations primaires d’une société, celle du mode de traitement des rapports de ces formations avec les formations secondaires dont la démocratie requiert l’existence, celle de la création même (et de la consolidation) de ces formations secondaires là où elles manquent à l’appel, convergent pour constituer une seule et même question. Et c’est bien cette question que les sociétés auxquelles on demande de devenir démocratiques sont obligées de se poser. Il s’agit là d’une question bien plus urgente que celle du rapport entre la démocratie et le développement. Ce qui, bien entendu, ne diminue en rien la nécessité de déterminer la mesure dans laquelle le développement constitue une voie – qui, certes, n’est ni sûre ni unique – vers l’aménagement d’une assise de la démocratie. On ne peut oublier, d’autre part, que la démocratie s’exporte, de nos jours, dans les bagages du néo-libéralisme. Or, en détrônant l’État-Providence dans des pays qui sont encore dépourvus de “sociétés civiles” convenablement structurées et disposant de ressources passablement suffisantes pour faire face aux charges que l’État laisse derrière lui en se retirant de l’arène sociale, le néo-libéralisme réduit les plus faibles (et une partie des moins faibles) à la nécessité de se débattre, pieds et poings liés, cette fois, dans l’inextricable filet de la misère. En effet, la structure même de l’État, dans ces pays, le fossé qui les sépare de l’État de droit, constituent un gagne-pain pour une multitude considérable qui jouit, par ce biais, d’une sécurité garantie tantôt par la Loi et tantôt par le laxisme de cette dernière et la possibilité couramment offerte de la détourner. Au Liban, par exemple, une masse de gens bénéficie, en plus de la sécurité sociale légale, de l’inflation des administrations étatiques, d’une sécurité pratiquement absolue de l’emploi et de pensions maquillées en subventions à la production ou en compensations de dégâts. Une partie de cette masse monnayent des parcelles, d’inégale importance, d’influence politique ou administrative contre des pots de vin ou des rackets. D’autres encore vivotent en pratiquant des professions illégales ou en outrepassant les conditions légales requises pour s’adonner à d’autres métiers ou occupations.
Au Liban, également, le secteur associatif offre au regard un essaim impressionnant d’associations entretenues par la société traditionnelle, c’est-à-dire par des communautés familiales, villageoises, confessionnelles, etc. Ces associations sont très souvent entretenues grâce à la mobilisation, rarement exempte de confessionnalisme, de communautés d’émigrés. Elles bénéficient également de l’appui d’États étrangers, proches ou lointains, pour lesquels le critère confessionnel compte également. Last but not least, elles échangent un soutien réciproque avec des personnages influents du milieu politique libanais. Tous cas qui se croisent pour former un tissu compliqué. Et c’est ce tissu dont la cohérence est assurée par la protection politique et le trafic d’influence, que menace de défaire le néo-libéralisme et l’État de droit. Car même l’émigré qui veut faire un don à une école dépendante d’une société de bienfaisance, s’adresse de préférence, à un parrain influent, susceptible de récompenser, un jour, son geste, ou dont la promotion parait indiscernable de celle de sa communauté et des institutions qui font la fierté de celle-ci. Les associations laiques ou assimilées, elles, restent en deca de leurs homologues traditionnelles, en nombre et en moyens. Quand elles ne sont pas carrément étrangères, elles demeurent plus ou moins handicapées par leur dépendance du financement étranger ou international. Qu’offre alors pour faire face à cet état de misère déguisé en sécurité, un néo-libéralisme déguisé en État de droit et ennemi de l’État-providence? Qu’a-t-il prévu pour préserver, là où il vient camper, la paix civile et tout ce qui dépend de son maintien? Se contentera-t-il de regarder d’un mauvais oeil les fonctionnaires corrompus au chômage, les malades chassés du paradis de l’assurance-maladie, le écoliers mis au ban des écoles, les familles privées de l’eau courante et de l’énergie gratuites, les cultivateurs de tabac nostalgiques des subventions de naguère…? Donnera-t-il à l’État de droit, après avoir promené son regard de feu sur ces nuées de sauterelles humaines, l’ordre d’arrêter tout terroriste déguisé en sauterelle? Ou bien, laissera-t-il ceux qui, hier encore, parasitait la société à partir de postes étatiques et l’État à partir de positions sociales, revenir à la charge en parasitant (en bons maffieux) la société à partir de positions sociales pour, de nouveau, investir les rouages étatiques? Et sinon, laissera-t-il aux destinataires de son appareil légal d’exportation, un répit pour méditer sur les conditions de préservation de leur paix civile et le loisir de les assurer?
Ce disant, nous n’ignorons guère que la démocratie, pour se développer, a besoin de lois et d’institutions et que nul n’est autorisé à dénigrer les garanties légales des libertés et la prévention de la tyrannie par la force de la Loi. Nous croyons cependant que l’instauration d’une démocratie authentique, compatible avec le maintien de la paix civile et la préservation, par voie de conséquence, de tout ce qui en dépend (c’est-à-dire, entre autres, de la démocratie elle-même) est une tâche que les dispositions légales restent loin d’épuiser; son accomplissement n’est point affaire d’import-export, en dépit du fait qu’avec le respect de délais temporels appropriés, des relations favorables avec l’environnement régional et mondial aident considérablement à bien s’en acquitter. En 1926, les Francais ont importé, pour notre compte, une Constitution dont on ne peut, en toute équité, que saluer le caractère éminemment démocratique. Ils l’ont importée de France, de Belgique et d’Égypte. Ce qui précède n’est que le sommaire de ce qu’en 77 ans, nous avons fait de cette Constitution. Sous l’effet de facteurs – dont nous encourons, pour l’essentiel, la responsabilité – nous n’avons pu avoir ni beaucoup de paix ni beaucoup de démocratie. Plus grave encore, en ce temps présent, est de constater que nous n’avons assuré ni plus de démocratie ni plus de paix pour les temps à venir.
*****
Ce pays est le seul que j’ai; ma loyauté ne va à nul autre. Le fait de me retrouver beaucoup moins attaché à ce qu’on appelle la “Formule” libanaise que le Président Mohammad Khatami remplit mon coeur de tristesse. Ce n’est pas une raison pour m’en excuser.
* Communication faite à la conférence sur Démocratie et Paix, organisée par la Commision internationale de l'Unesco pour la Paix et le Développement, la Section de la Philosophie et des Sciences humaines à l'Unesco (Paris) et le Centre International des Sciences de l'Homme (Byblos, Liban) et réunie à Beyrouth les 2 et 3 juin 2003.
(Texte traduit de l’arabe par l’auteur en juillet-août 2003)