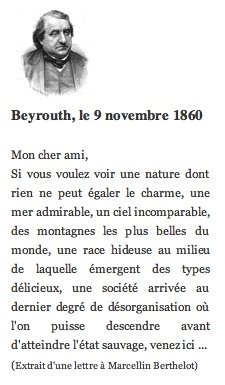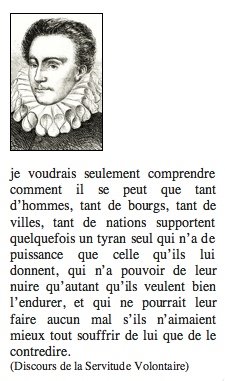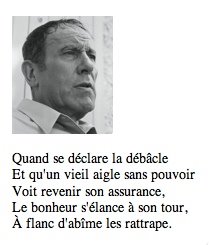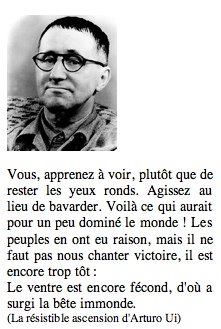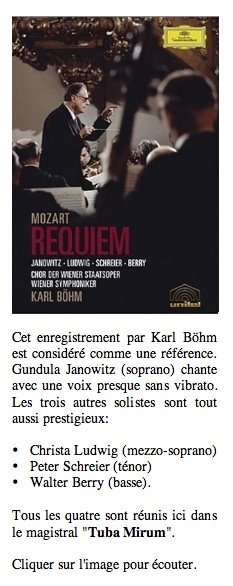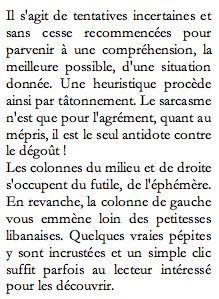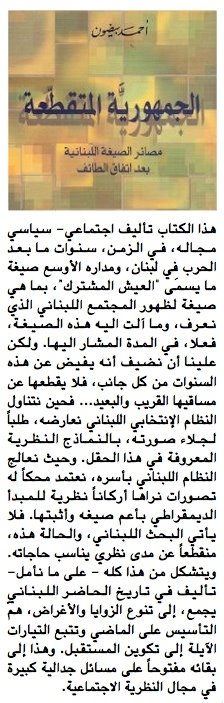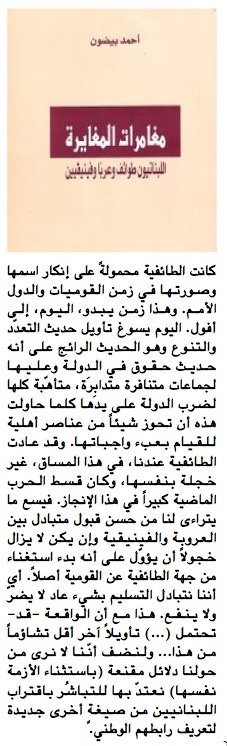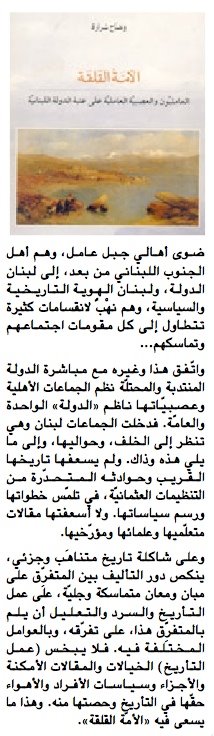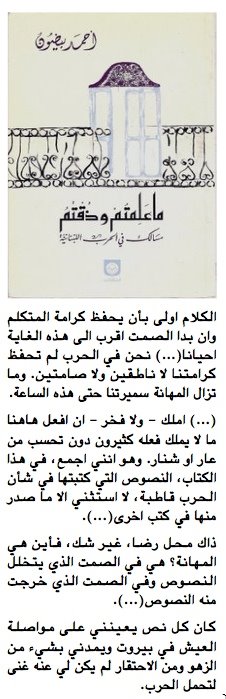Ahmad Beydoun à propos de Fayrouz et Ziad
Ou comment l'art de l'écriture rime avec ciselure.
Bien que le propos de ce blog soit "politique", les escapades hors champ, sans être fréquentes, ne sont pas impossibles surtout lorsqu'il s'agit de signaler un événement culturel exceptionnel ou de signaler un texte d'une grande qualité esthétique qui vient rompre avec le ronron nauséeux du microcosme politique libanais. La disparition récente de Mohammad Al Maghout a fourni une première occasion qui a permis de rendre hommage au grand poète syrien en offrant au lecteur la possibilité de lire ou de relire trois de ses plus beaux poèmes. L'événement aujourd'hui est autrement gai et le texte d'une beauté pétillante!
Il s'agit d'un colloque, au sujet de Fayrouz et des frères Rahbani, qui s'est récemment tenu à l'Université Américaine de Beyrouth et qui a permis à Ahmad Beydoun de s'extraire provisoirement du champ clos de la "formule" afin de livrer sa perception, probablement rédigée sous l'effet bénéfique d'un "clair de lune", des "mots de Ziad chantés par Fayrouz".
Ce texte, publié ici dans son intégralité, donne l'occasion à Ahmad Beydoun de prouver une nouvelle fois les multiples facettes de son talent de grand littérateur.
Chacun de ses textes, et celui-ci en particulier, donne l'impression de tenir en soi comme s'il s'agissait d'un objet en apesanteur, affranchi de toute contrainte externe, y compris parfois du sujet traité. Je le soupçonne même d'avoir pris Ziad Rahbani comme prétexte pour se livrer à des exercices de style aux variations infinies que rien ne semble pouvoir arrêter si ce n'est la longueur du texte qu'il doit s'être lui-même préalablement imposé. Il faut toutefois admettre que le sujet s'y prêtait facilement: la voix de Fayrouz saisie à son point d'intersection entre la prose rimée des parents (Assi et Mansour) et celle du fils (Ziad). En s'adonnant à sa passion, Ahmad Beydoun ne néglige pas pour autant son sujet. Tout au contraire, celui-ci reçoit pleinement son dû et les idées développées dans le texte trouvent leurs conclusions heureuses avec la clarté et la perfection d'une démonstration mathématique.
Le lecteur aura vite compris de quel côté le coeur de l'auteur balance. La prose sans queue ni tête de Ziad ne sied pas à la voix "couleur d'argent" de Fayrouz. Cette prose sur laquelle se penche avec application Ahmad Beydoun, réputé justement pour la qualité de la sienne, aurait facilement pu faire l'objet de flèches assassines, mais il aurait été inconvenant de le faire en la circonstance et puis l'auteur reconnaît à Ziad le don d'artiste dont les pièces de théâtre et la musique continuent à séduire le grand nombre.
Ceci ne l'empêche pas de noter au passage qu'en déconstruisant la prose générique paternelle et en amenant sa mère à chanter la sienne (sublimation par excellence de la relation incestueuse impossible), Ziad croit être ainsi parvenu à résoudre son complexe d'œdipe.
L'écriture en pointillé de Ziad semble provoquer une gêne à peine contenue chez le styliste Beydoun qui préfère à l'inconvenante attaque frontale la simple dérision dont l'avantage est de rendre le lecteur complice (lire sur ce point le passage délicieux sur les implications linguistiques consécutives à l'utilisation des verbes être, dire et manger dans les exemples donnés: "Hassan mange" et "Hassan dit").
Comme on le voit, Ahmad Beydoun préfère prendre la tangente. Tout en relevant la part d'espièglerie dans la prose de Ziad, il se livre lui-même à un exercice d'espièglerie de haute voltige, non sans avoir au préalable déclaré sa flamme à la voix de Fayrouz qui "titille l'âme", même si, pour l'occasion, il se trouve obligé d'en admettre l'existence.
Le lecteur, qui aura navigué et tangué avec le texte jusqu'à l'escale terminale, éprouve immédiatement le besoin d'une deuxième lecture. C'est à ce moment seulement que le texte dégage toute sa beauté, le sujet, relégué au deuxième plan, cède la place au style pour qu'il brille dans toute sa splendeur.
Ahmad Beydoun joue littéralement avec la langue. Il pousse les mots jusqu'à leur faire rendre tout leur suc. La phrase semble tirée, polie, astiquée comme un diamant juste extrait de sa gangue. La délectation du lecteur est telle qu'il peut facilement imaginer l'auteur en artisan d'art en train de donner ses petits coups de ciselet et d'admirer seul dans son atelier la finition de son œuvre avant de pouvoir enfin la livrer à l'admiration des connaisseurs.
Le sujet est un prétexte, mais les mots le sont aussi. Ils ne constituent pas seulement le réservoir dans lequel l'auteur vient piocher pour construire sa phrase, mais des "êtres" indépendants assujettis aux variations du style sur lesquels il prend appui pour rebondir vers d'autres mots. En d'autres termes, ce sont les mots qui génèrent les mots et non plus le sujet traité. On reconnaît-là l'une des techniques d'improvisation du jazz qui s'appuie sur un accord prétexte pour créer une mélodie nouvelle. On retrouve la même technique d'oubli du point de départ avec les "impromptus" de Schubert (le n°2 particulièrement où l'on sent la musique jaillir de la musique elle-même).
Une illustration parfaite de ce qui précède se trouve dans le passage où Ahmad Beydoun prend prétexte de quelques panneaux publicitaires fixés sur des poteaux pour se livrer à un délire désopilant d'improvisation. Ce n'est plus Ziad qui est le centre d'intérêt mais le Poteau et le Titre porté par les panneaux qui font l'objet de l'improvisation. Le poteau devient un personnage qui descend dans l'arène du langage pour compléter, grâce à sa contribution "personnelle", le sens escamoté (intentionnellement ou non par Ziad) de l'annonce. On en glousse de plaisir.
Ahmad Beydoun ne clôt pas son texte sans avoir préparé son retour forcé dans le bruit et la fureur de la ville "sans cœur". Il en profite pour rajouter une "petite retouche" aux tableaux qu'il avait brossé de Beyrouth, dix ans auparavant, dans son livre "La République Intermittente" et de noter avec amertume la transformation définitive de la capitale en une ville de "banlieues" et de "marges" désertée par ses habitants et réservant son cœur "à la promenade, au boire et au manger".
Ou comment l'art de l'écriture rime avec ciselure.
Bien que le propos de ce blog soit "politique", les escapades hors champ, sans être fréquentes, ne sont pas impossibles surtout lorsqu'il s'agit de signaler un événement culturel exceptionnel ou de signaler un texte d'une grande qualité esthétique qui vient rompre avec le ronron nauséeux du microcosme politique libanais. La disparition récente de Mohammad Al Maghout a fourni une première occasion qui a permis de rendre hommage au grand poète syrien en offrant au lecteur la possibilité de lire ou de relire trois de ses plus beaux poèmes. L'événement aujourd'hui est autrement gai et le texte d'une beauté pétillante!
Il s'agit d'un colloque, au sujet de Fayrouz et des frères Rahbani, qui s'est récemment tenu à l'Université Américaine de Beyrouth et qui a permis à Ahmad Beydoun de s'extraire provisoirement du champ clos de la "formule" afin de livrer sa perception, probablement rédigée sous l'effet bénéfique d'un "clair de lune", des "mots de Ziad chantés par Fayrouz".
Ce texte, publié ici dans son intégralité, donne l'occasion à Ahmad Beydoun de prouver une nouvelle fois les multiples facettes de son talent de grand littérateur.
Chacun de ses textes, et celui-ci en particulier, donne l'impression de tenir en soi comme s'il s'agissait d'un objet en apesanteur, affranchi de toute contrainte externe, y compris parfois du sujet traité. Je le soupçonne même d'avoir pris Ziad Rahbani comme prétexte pour se livrer à des exercices de style aux variations infinies que rien ne semble pouvoir arrêter si ce n'est la longueur du texte qu'il doit s'être lui-même préalablement imposé. Il faut toutefois admettre que le sujet s'y prêtait facilement: la voix de Fayrouz saisie à son point d'intersection entre la prose rimée des parents (Assi et Mansour) et celle du fils (Ziad). En s'adonnant à sa passion, Ahmad Beydoun ne néglige pas pour autant son sujet. Tout au contraire, celui-ci reçoit pleinement son dû et les idées développées dans le texte trouvent leurs conclusions heureuses avec la clarté et la perfection d'une démonstration mathématique.
Le lecteur aura vite compris de quel côté le coeur de l'auteur balance. La prose sans queue ni tête de Ziad ne sied pas à la voix "couleur d'argent" de Fayrouz. Cette prose sur laquelle se penche avec application Ahmad Beydoun, réputé justement pour la qualité de la sienne, aurait facilement pu faire l'objet de flèches assassines, mais il aurait été inconvenant de le faire en la circonstance et puis l'auteur reconnaît à Ziad le don d'artiste dont les pièces de théâtre et la musique continuent à séduire le grand nombre.
Ceci ne l'empêche pas de noter au passage qu'en déconstruisant la prose générique paternelle et en amenant sa mère à chanter la sienne (sublimation par excellence de la relation incestueuse impossible), Ziad croit être ainsi parvenu à résoudre son complexe d'œdipe.
L'écriture en pointillé de Ziad semble provoquer une gêne à peine contenue chez le styliste Beydoun qui préfère à l'inconvenante attaque frontale la simple dérision dont l'avantage est de rendre le lecteur complice (lire sur ce point le passage délicieux sur les implications linguistiques consécutives à l'utilisation des verbes être, dire et manger dans les exemples donnés: "Hassan mange" et "Hassan dit").
Comme on le voit, Ahmad Beydoun préfère prendre la tangente. Tout en relevant la part d'espièglerie dans la prose de Ziad, il se livre lui-même à un exercice d'espièglerie de haute voltige, non sans avoir au préalable déclaré sa flamme à la voix de Fayrouz qui "titille l'âme", même si, pour l'occasion, il se trouve obligé d'en admettre l'existence.
Le lecteur, qui aura navigué et tangué avec le texte jusqu'à l'escale terminale, éprouve immédiatement le besoin d'une deuxième lecture. C'est à ce moment seulement que le texte dégage toute sa beauté, le sujet, relégué au deuxième plan, cède la place au style pour qu'il brille dans toute sa splendeur.
Ahmad Beydoun joue littéralement avec la langue. Il pousse les mots jusqu'à leur faire rendre tout leur suc. La phrase semble tirée, polie, astiquée comme un diamant juste extrait de sa gangue. La délectation du lecteur est telle qu'il peut facilement imaginer l'auteur en artisan d'art en train de donner ses petits coups de ciselet et d'admirer seul dans son atelier la finition de son œuvre avant de pouvoir enfin la livrer à l'admiration des connaisseurs.
Le sujet est un prétexte, mais les mots le sont aussi. Ils ne constituent pas seulement le réservoir dans lequel l'auteur vient piocher pour construire sa phrase, mais des "êtres" indépendants assujettis aux variations du style sur lesquels il prend appui pour rebondir vers d'autres mots. En d'autres termes, ce sont les mots qui génèrent les mots et non plus le sujet traité. On reconnaît-là l'une des techniques d'improvisation du jazz qui s'appuie sur un accord prétexte pour créer une mélodie nouvelle. On retrouve la même technique d'oubli du point de départ avec les "impromptus" de Schubert (le n°2 particulièrement où l'on sent la musique jaillir de la musique elle-même).
Une illustration parfaite de ce qui précède se trouve dans le passage où Ahmad Beydoun prend prétexte de quelques panneaux publicitaires fixés sur des poteaux pour se livrer à un délire désopilant d'improvisation. Ce n'est plus Ziad qui est le centre d'intérêt mais le Poteau et le Titre porté par les panneaux qui font l'objet de l'improvisation. Le poteau devient un personnage qui descend dans l'arène du langage pour compléter, grâce à sa contribution "personnelle", le sens escamoté (intentionnellement ou non par Ziad) de l'annonce. On en glousse de plaisir.
Ahmad Beydoun ne clôt pas son texte sans avoir préparé son retour forcé dans le bruit et la fureur de la ville "sans cœur". Il en profite pour rajouter une "petite retouche" aux tableaux qu'il avait brossé de Beyrouth, dix ans auparavant, dans son livre "La République Intermittente" et de noter avec amertume la transformation définitive de la capitale en une ville de "banlieues" et de "marges" désertée par ses habitants et réservant son cœur "à la promenade, au boire et au manger".